J’ai développé dans un article précédent les raisons de mon indignation provoquée par la lecture du vôtre.
Il me reste un dernier point à développer : les raisons de mon désaccord avec votre vision du monde ou du moins de l’éducation. Ma diatribe étant d’objectif modeste, je me limiterai au seul point d’intersection possible : l’école prépare-t-elle à rentrer dans votre monde, c’est-à-dire dans celui de l’entreprise ?
L’introduction qui précède votre article précise que vous invitez les jeunes à devenir entrepreneur. C’est à coup sûr un bel objectif, et je me satisfais de constater que vos ambitions sont sans limites, puisque vous leur offrez l’exemple de Larry Page et de Sergey Brin. Mais, d’emblée, je me dis que nous ne vivons pas dans le même monde car, dans le collège dans lequel je travaille, pas moins de 52 % des élèves sont issus d’un milieu défavorisé. C’est vous dire qu’ils ne sont pas prêts à balancer de leur garage l’algorithme qui va bouleverser le monde.
Je ne vais certes pas bâtir mon argumentation sur un misérabilisme larmoyant, mais il serait intéressant que vous les voyiez ces jeunes, et que vous compreniez que leurs préoccupations sont à mille lieues des vôtres. Vous semblez rêver d’une jeunesse galopante et rayonnante débarrassée de ces enseignants parasitaires freinant son élan. Hélas ! ce jeune public est davantage concerné par ses petits problèmes : un parent qui vient de se suicider, un autre qui a mis son enfant à la porte, un abus sexuel, une dyslexie mal traitée, etc. Malgré tout cela, ces enfants parfois en très grande difficulté scolaire sont contrairement à ce que vous dites ponctuels, polis et respectueux. En revanche, ils accroissent les «bataillons d’illettrés» dont vous parlez. À qui la faute ?
Cela, c’est pour remettre les choses dans leur contexte, et je peux vous dire que j’ai grandement édulcoré les choses.
À présent, demandons-nous ce que ces collégiens deviennent. J’en viendrai directement au point qui nous intéresse : les «meilleurs» vont au lycée, c’est-à-dire presque tous. Comment pourrait-il en aller autrement ? Lorsqu’on veut emmener 80% d’une classe d’âge au baccalauréat, il n’est pas étonnant que ce soit pratiquement tous nos élèves qui accèdent au lycée. Au reste, je maintiens que cet objectif n’a rien de scandaleux, sauf pour les nostalgiques du charme discret de la bourgeoisie, qui aimaient tant que l’élite soit l’élite, c’est-à-dire une catégorie sociale non souillée de la présence des prolétaires venant outrageusement faire baisser le niveau.
Nos collégiens deviennent donc des lycéens en accédant soit au lycée général et technique soit au lycée professionnel. Le deuxième choix, car c’est presque toujours un deuxième choix, voit des élèves arriver qui n’ont pas envie d’être là. Aujourd’hui, on considère toujours qu’il vaut mieux faire de la philosophie que de la mécanique, rappelle François Dubet. C’est dire que ces élèves à qui on a fait comprendre que le lycée général et technique n’était pas pour eux n’ont pas envie d’être là. Bien souvent, ils y sont malgré eux. C’est dommage, mais c’est ainsi. Quelles peuvent être alors leurs motivations ? À eux dont les médias rabâchent à longueur de journée que de grands patrons s’octroient des salaires pharaoniques, parfois doubles, avant de fermer l’entreprise pour ensuite délocaliser. Quelle est à votre avis leur opinion sur le monde de l’entreprise, eux qui voient papa et maman chômer ?
Le problème est donc là : l’école n’est plus un gage de réussite. Tant et si bien qu’on ne sait plus comment motiver nos élèves. Dans certains cas, on propose même des cagnottes de 10000€. C’est vous dire le désarroi qui a dû s’emparer des têtes pensantes de notre ministère.
Mais quand bien même le monde qui les attend regorgerait d’emplois à qui mieux mieux, qu’en serait-il exactement ? Faudrait-il préparer nos élèves à rentrer dans la vie active ?
Pour moi, et je ne me lasserai jamais de le répéter, la réponse est non, mille fois non. Les élèves eux-mêmes le savent, eux qui effectuent leur scolarité. L’univers dans lequel ils évoluent – celui de l’école – n’est pas la réalité. C’est un monde à part dans lequel l’erreur est tolérée, la faute acceptable. C’est un monde dans lequel on peut recommencer sans être condamné, méprisé ou ostracisé : si je rate un contrôle, je peux le recommencer, je peux refaire une année, je peux recevoir de l’aide ; si, d’aventure, je commets une bêtise (je me bats, par exemple) je ne paie pas d’amende, je ne vais pas en prison. Je suis éduqué, élevé, non pas condamné. Il n’existe qu’un seul cas où le réel rencontre l’école : c’est lorsqu’un enfant ayant commis et répété de graves forfaits se voit traîné en conseil de discipline et que celui-ci se prononce pour l’exclusion définitive de l’élève. Là, en voyant le regard de l’enfant, on comprend qu’il n’avait pas saisi que le réel le rattrapait.
Le réel ! Le moins que l’on puisse dire est qu’il varie en fonction de divers facteurs. Qu’est-ce que cela veut dire le réel, et surtout préparer nos enfants au monde réel? Au XVIIe siècle, cela ne voulait sûrement pas dire grand-chose : un état dans lequel tout un chacun aurait reçu une éducation, aurait son mot à dire dans une démocratie serait un non-sens. Après la Révolution française, les choses sont un peu différentes, mais combien de petits Français reçoivent les lumières de l’éducation ? Ce n’est que progressivement, au XIXe siècle, que les Français vont accéder de plus en plus nombreux à l’école, mais pourquoi faire ? L’enfant apprend à compter, à lire et à écrire. Cela est bien suffisant, et de toute façon la moisson mobilisera bientôt toute l’énergie de la famille. Dans l’industrialisation croissante de ce siècle, à quoi faut-il préparer les enfants ? Au travail que le monde est en mesure de leur donner ? À travailler dans une mine, à travailler dans une manufacture ? À faire la guerre pour lutter contre les Prussiens ? Ce qui n’est pas encore l’Éducation nationale n’a-t-il pour autre objectif que de préparer l’enfant à recevoir ce que le monde veut bien lui donner ? Dans le nôtre, que faudrait-il apprendre ? À mépriser La Princesse de Clèves, à s’adapter à telle technologie tant que nous en avons besoin (pensez aux cassettes vidéo de Sony dans les Landes), puis à les mettre à la porte ?
Ce n’est pas là ma conception de l’école.
Mieux encore. Selon moi, l’école est incompatible avec la logique de l’entreprise et de l’idéologie du libéralisme qui voit ou veut voir dans l’individu un être compétitif, prêt à écraser l’autre, ce qui est bien, en dernière analyse, l’exemple que vous donnez en évoquant Larry Page et Sergey Brin. Ne sont-ils pas à l’origine de l’entreprise qui, tel un monstre mythologique, avale tout, diminue ou écrase la concurrence c’est-à-dire des individus ?
Or rien de tel dans une classe. Si l’on fait de la pédagogie différenciée, la classe est divisée en petits groupes mêlant les élèves dont les meilleurs aident les moins forts. Il faudrait d’ailleurs s’entendre sur ce terme : le meilleur dans une classe n’est pas forcément le plus intelligent, mais parfois le plus chanceux, le plus mûr, le plus sérieux, le plus docile (ou le moins réfractaire), celui qui est passionné ou seulement intéressé. Dans un tel contexte, ledit meilleur n’a pas pour objectif d’écraser l’autre, mais bien de l’aider. Et tout l’enjeu de mon enseignement sera de le leur expliquer. Je tenterai également de leur parler de tout ce qui sera profondément inutile, la littérature. Vous qui aimez l’économie, permettez-moi d’y faire référence. L’enseignement de la littérature, c’est l’équivalent de ce que Georges Bataille appelait la part maudite, la dépense pour rien. Il n’y a rien de plus détestable que cette instrumentalisation de l’école, sa subordination au monde du travail. L’enseignement n’est pas utilitaire. Je n’enrôle pas de futurs chômeurs.
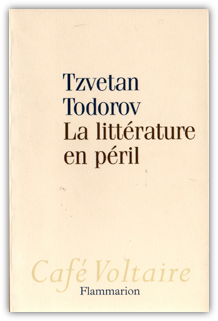

 Un ami m’a prêté
Un ami m’a prêté  J’adore le babil des nourrissons, la lallation plus précisément. J’adore provoquer ces sons qui précèdent l’acquisition du langage articulé.
J’adore le babil des nourrissons, la lallation plus précisément. J’adore provoquer ces sons qui précèdent l’acquisition du langage articulé.
 Aujourd’hui, j’ai envie d’entamer un chant de louange et d’allégresse à l’iPod.
Aujourd’hui, j’ai envie d’entamer un chant de louange et d’allégresse à l’iPod. J’ai fini par en acquérir un, puis deux, puis trois, véritable tonneau des danaïdes. Jamais remplis. Je passe mon temps à déverser là-dedans toutes sortes de fichiers. Et depuis l’iPod touch, les possibilités se sont accrues.
J’ai fini par en acquérir un, puis deux, puis trois, véritable tonneau des danaïdes. Jamais remplis. Je passe mon temps à déverser là-dedans toutes sortes de fichiers. Et depuis l’iPod touch, les possibilités se sont accrues.