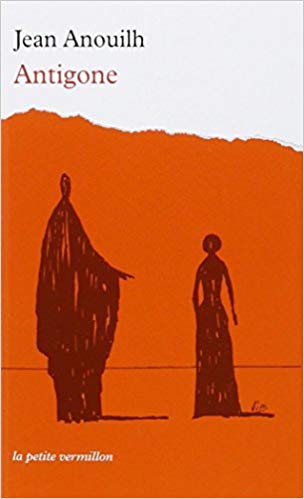Antigone de Jean Anouilh
Je ne sais rien de Jean Anouilh. Je n’ai lu qu’une seule de ses pièces, Antigone. Je vous livre donc simplement, pêle-mêle les réflexions qui me sont venues à l’esprit après la double lecture que j’ai faite de cette tragédie.
Tout d’abord, je me suis dit que s’attaquer à la tragédie grecque, s’inscrire dans le prolongement de Sophocle était un tour de force qui méritait le respect (1).
Jean Anouilh avoue sa passion pour le tragédien grec : « […] je me suis glissé dans la tragédie de Sophocle comme un voleur mais un voleur scrupuleux — et amoureux de son butin ». L’écrivain est donc un lecteur qui vole scrupuleusement l’objet de son amour, la lecture. Quelle jolie définition de la création littéraire !
Dans la postface toujours, Anouilh dit deux choses fort intéressantes.
Une œuvre résonne différemment selon l’époque à laquelle elle est lue. C’est peut-être ça un classique, une œuvre qui s’enrichit des lectures qui en ont été faites. Mais surtout, il faut lire la pièce avec dans l’idée que la guerre imprime à chaque mot une résonance particulière.
Enfin, il explique que ce qui est beau dans la tragédie, « c’est de connaître d’avance le dénouement. C’est ça le vrai ‶suspense″ ».
Ce dernier point me semble particulièrement intéressant. Le chœur y revient d’ailleurs, transformant la pièce en manifeste, en art poétique de la tragédie. Établissant une différence entre le drame et la tragédie, le chœur explique :
« Dans la tragédie on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme ! Ce n’est pas parce qu’il y en a un qui tue et l’autre qui est tué. C’est une question de distribution. Et puis, surtout, c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, — pas à gémir, non, pas à se plaindre, — à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à dire, qu’on avait jamais dit et qu’on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien : pour se le dire à soi, pour l’apprendre, soi » (page 54).
Dans la tragédie, il n’y a donc pas de coupable. S’il y en a qui tue et l’autre qui est tué, c’est une question de distribution. Le mot relève du vocabulaire théâtral. On distribue les rôles (il y a le roi, il y a Antigone qui s’oppose au pouvoir royal…), mais ce n’est pas un jeu. C’est la vraie vie. Antigone le dit quand Créon lui demande quel jeu elle joue : « Je ne joue pas », répond Antigone (page 70). De plus, la partie étant « jouée » d’avance (on l’a vu, le dénouement est connu dès le début ; voir également le prologue pages 9 à 13), l’idée même de jeu n’a pas de sens. L’issue est la mort. Au reste, le personnage d’Eurydice, absent textuellement (elle ne dit pas un mot), a une grande importance du point de vue scénique, puisqu’elle tricote tout au long de la pièce. Sorte de Parque, l’arrêt de sa tâche signifie la fin de sa vie et de celle de tous les autres à l’exception d’Ismène et de Créon, mais ces derniers ne sont pas des personnages tragiques, comme Antigone ou Hémon. Créon, se comparant à Œdipe, ne dit pas autre chose :
« Et si demain un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m’annoncer qu’il n’est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s’en retourner d’où il vient et je ne m’en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille » (page 69).
Pour Créon, le tragique (ou du moins ce qui l’est pour Œdipe ou Antigone) n’est que « du pathétique personnel », c’est « si peu » ! Cependant, Créon dit cela avant même d’avoir compris quelle était son erreur.
Tout le passage confrontant Antigone à Créon est un véritable morceau d’anthologie. Or il est intéressant de constater que ce passage peut être divisé en deux parties.
Tout d’abord, Créon essaie de comprendre l’acte d’Antigone. Il veut la sauver. Il la soupçonne d’avoir transgressé l’ordre royal parce qu’elle est fille de roi et que, le sachant, elle pense pouvoir échapper au châtiment. Puis Créon en vient à croire qu’Antigone, comme son père, est orgueilleuse (« L’humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort », page 68). Devant les refus obstinés d’Antigone d’être sauvée, Créon tente de lui faire comprendre l’absurdité de son geste : « Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique » (page 76).
Quelle est cette histoire politique ? Pour la lui faire comprendre, Créon va se montrer odieux. Après avoir battu en brèche les innocents souvenirs d’Antigone, il lui dépeint une famille pitoyable pour laquelle mourir n’a pas de sens (pour le coup, on est davantage dans le drame voire le vaudeville que dans la tragédie avec des enfants odieux, des parents qui pleurent, etc.). Pire, Créon avait besoin d’un héros et d’un traître. L’un devait servir d’exemple, l’autre d’avertissement à toute velléité de révolte (2).
Mais comment choisir le héros ? Cela pourrait sembler simple, et pourtant :
« […] il s’est trouvé que j’ai eu besoin de faire un héros de l’un d’eux. Alors, j’ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés — pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s’étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argyenne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J’ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j’ai donné l’ordre de laisser pourrir l’autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t’assure que cela m’est égal » (page 89).
Créon a donc détruit les souvenirs familiaux de sa nièce, et réduit à l’insignifiant sa volonté de donner une sépulture à Polynice. À ce moment, Créon pense l’avoir emporté, et il ne sera plus vraiment question du frère privé de sépulture. En revanche, une opposition très nette se met en place. Créon est celui qui a dit oui. Antigone est celle qui dit non.
Créon est roi, il ne voulait pas l’être, il a accepté de l’être. Alors qu’il pouvait dire non, il explique :
« […] je me suis senti tout d’un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m’a pas paru honnête. J’ai dit oui » (page 78).
Il ne tenait pas particulièrement au pouvoir, mais il a accepté. Il a abandonné tout ce qu’il aimait pour jouer « au jeu difficile de conduire les hommes » (page 11), parce que, dit-il, « Il faut […] qu’il y en ait qui dise oui. Il faut […] qu’il y en ait qui mènent la barque » (page 81). Il doit donc jouer son rôle jusqu’au bout (c’est une question de distribution), et donc faire mourir Antigone.
Antigone est celle qui dit non. Créon est un vieil homme qui l’écoute « du fond du temps ». Il admire sa « force » et son « élan » (page 91). Il lui explique que la vie, le bonheur sont accessibles au prix de petits mensonges (« Rien n’est vrai que ce qu’on ne dit pas », page 91). Antigone va alors dire à non à cette vie. Elle s’oppose dorénavant à Créon non pas parce qu’elle transgresse ses ordres, mais parce qu’elle le méprise du haut de sa jeunesse, un temps inaccessible pour le vieil homme (« Je vous parle de trop loin maintenant, d’un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre », page 94). Ce royaume n’est pas seulement cette jeunesse qui fait la force et l’élan d’Antigone, ce n’est pas seulement le temps qui s’écoule (3), c’est le royaume de celle qui a côtoyé la mort et qui se positionne d’un côté ou de l’autre : vivre ou trépasser, mais sans compromission, cela parce que sa confiance a été définitivement ébranlée par Créon :
« Moi, je veux tout, tout de suite, — et que ce soit entier — ou alors je refuse ! Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d’un petit morceau si j’ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd’hui et que cela soit aussi beau que quand j’étais petite — ou mourir » (page 95).
Ainsi Créon a échoué avec Antigone, comme il échouera avec Hémon (voir pages 103 et 105). C’est en un récit, comme il se doit dans la tragédie, que l’on apprend la fin de chacun des personnages : Antigone emmurée et pendue, Hémon qui l’a suivie dans la tombe et qui, après avoir craché au visage de son père qui l’a entendu crier de douleur, se plonge l’épée dans le ventre, Eurydice se suicidant à son tour (4).
La pièce s’achève dans le sang, et c’est le chœur, personnage ô combien important, qui formule la conclusion :
« Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire — même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l’histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris » (page 123).
À aucun moment de la pièce, les allusions à la guerre ne se sont mieux fait ressentir.
Notes :
1 — Bien sûr, il n’est pas le seul. Cocteau ou Sartre ont fait de même mais, selon moi, Cocteau a produit des œuvres indigestes, et Sartre s’est éloigné de la tragédie pour faire des pièces très… sartriennes.
2 — Il l’avait déjà sous-entendu : « Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville, pendant un mois » (page 77).
3 — Voir page 91 ce que dit Créon à propos de la vie : « C’est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir […] ».
4 — Lire la réplique du messager (pages 118 à 119) et celle du chœur (pages 119 à 120).